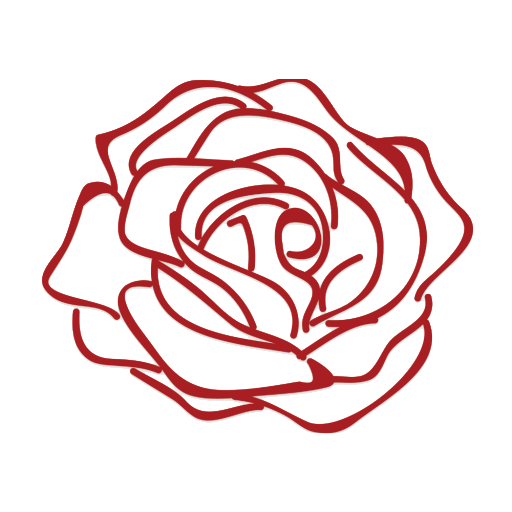 Groupe Socialiste Universitaire
Groupe Socialiste UniversitairePosté le 9 novembre 2022 par Groupe Socialiste Universitaire

Attention ! Voici un livre qui s’exclame. Ça réveille. Woke. Ah non ! diront certain.e.s, lassé.e.s des plaintes désormais incessantes qui animent les couloirs, parfois même les salles de classe de l’université. Chut ! Silence ! On travaille ici. Et bien nous aussi.
La plainte, celle que l’on dépose, celle que l’on vit ; celle que l’on soumet à une institution contre une personne ayant commis un abus, celle qui donne à entendre la douleur jusqu’alors sourde, provoquant parfois l’abandon des études, la démission d’un poste, la perte d’une vie.
Sara Ahmed, au Royaume-Uni, a souhaité tendre une « oreille féministe » à celleux qui déposent et souffrent d’une plainte, pour celleux à qui les collègues, les professeurs, les pairs suggèrent d’arrêter de se plaindre, face à qui l’institution déploie un mur de silence : portes fermées, messages sans réponse, démarches ad nauseum. Il n’y a pas lieu pour se plaindre, il n’y a pas lieu de se plaindre. « Complaint ! » donne lieu, porte ouverte pour porte-voix, chair du texte contre machineries du non-lieu, cri assertif. Faites place, ça crève les yeux, c’est assourdissant, imbuvable, ça prend aux tripes.
A l’université, le harcèlement moral, sexuel, raciste, handi pas du tout friendly est toléré, ses mots, ses attouchements, ses escaliers, ses regards, ses palpations qui font palpiter le cœur. C’est écœurant : L’administration universitaire le valide en le rendant presque impossible à dénoncer et à sanctionner. L’institution s’en défend, puisqu’elle est dotée de protocoles permettant un dépôt de plainte. Pourtant, ces protocoles, lorsqu’on s’y colle, « sticky », empêchent la plainte de décoller. Pire, la plainte colle à la peau de celleux qui se sont plaints. « Quand on dénonce le problème, on devient le problème. »
Après avoir démissionné d’un poste de professeure, parce qu’une plainte collective à l’encontre d’un collègue pour harcèlement sexuel n’aboutit pas, Sarah Ahmed devient chercheuse et enseignante indépendante. Dans ce livre qui tambourine contre la porte du silence institutionnel, elle prend à bras la plume ce paradoxe insupportable de la plainte académique. Elle est allée écouter de très nombreuses personnes et raconte avec son style d’écriture si caractéristique comment le harcèlement marche parce que sa dénonciation ne marche pas.
Attention, c’est une lecture difficile, qui peut réveiller des traumatismes. C’est une lecture difficile, car elle rend très claire la facilité avec laquelle une plainte est retournée contre la personne qui la porte, rajoutant violence à la violence. C’est une lecture importante, car elle transgresse un tabou : ne pas parler de ce qui fait trop de mal, car « nous », incarnations de l’institution académique, sommes respectables.
C’est une lecture instructive. A travers le prisme de la plainte, l’autrice propose une « phénoménologie de l’université » et de ses rapports de pouvoir. Une étudiante raconte l’échec à faire changer une règle de la politique des conflits d’intérêt de son institution. « Le Collège ne souhaite pas prévenir, ou même être au courant, de liaisons entre le corps professoral et les étudiants, et il revient à l’intégrité des deux parties d’assurer que des abus de pouvoir ne soient pas perpétrés. » Parce que cela ne la regarde pas, cela devient non seulement possible, mais facile. Si l’étudiant.e s’entête, on propose de laver son linge en famille : une confrontation avec l’agresseur est proposée, pour une résolution à l’amiable. Restons en bons termes, aller, on tire un trait, on ne va pas remuer la merde, tout de même, ça ne se fait pas entre gens de « haute éducation » (higher education, enseignement supérieur). On peut aussi ouvrir les yeux, iels le disent toustes : c’est insupportable voire insurmontable, ce face-à-face. La sueur aigre de la peur imprègne l’air irrespirable. Etouffer l’affaire, soumettre un peu plus. N’en restons pas là, l’institution académique peut instrumentaliser l’ensemble : on propose à une plaignante dont les emails protocolaires restent lettres mortes de participer au dépôt d’une candidature à un prix pour l’égalité des genres.
Audre Lorde a parfaitement dénoncé ce type de mécanismes dans son essai fameux « The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House. » Non seulement les protocoles de dépôt de plainte sont faits pour qu’elle n’aboutisse pas, mais celleux qui s’en saisissent peuvent être utilisé.e.s pour détourner le regard et lustrer l’université de sa masquarade. Pas woke, c’est trop bruyant, mais porte-parole, c’est fort brillant. Une noire, une lesbienne, un homosexuel, un ou une handicapé.e (parité, n’est-ce pas ?) siègent au comité de la diversité académique. « Tokenisation ». Plus une personne représente une minorité, plus on lui propose de siéger dans un comité. Par contre, il ne s’agirait pas de réveiller l’eau qui dort. C’est épuisant, c’est désarmant lorsqu’on y perd sa place car on « a mentionné des choses sur le racisme. »
Une « pédagogie féministe » consiste donc à nous apprendre que le privilège « est un instrument d’économie d’énergie. Etre épargné.e d’avoir à se plaindre, c’est économiser son énergie. » Cette énergie peut être mise à contribution pour ses compétences académiques et leurs rapports d’activité. Succès, promotions, réussites. Prestige. Survivre dans l’institution, s’y plaindre, s’y épuiser n’est pas une compétence académique.
Les alliances féministes ne sont pas non plus des compétences, mais elles peuvent aider à survivre. Trouver d’autres personnes avec qui s’exclamer. Faire la lumière sur les sombres rapports de pouvoir reproduits dans le traitement du harcèlement à l’université, et se reposer dans la demi-pénombre ainsi créée.
« Vous voilà, à vous affairer à vos affaires, petits fantômes, petits oiseaux, grattant quelque chose, essayant de faire de la place, de créer un nid, à partir de ce qui a été laissé derrière, à partir de ce qui a été dispersé. Une plainte peut ouvrir la porte à celleux qui sont venu.e.s avant. »
Compte-rendu de Noémie Merleau-Ponty (CNRS)