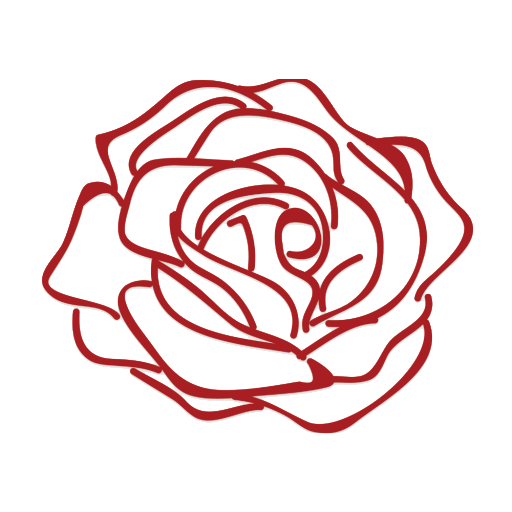 Groupe Socialiste Universitaire
Groupe Socialiste UniversitairePosté le 25 février 2021 par Groupe Socialiste Universitaire

Le 18 septembre 2020, un étudiant en droit de Montpellier démarre une grève de la faim. Le 23 septembre, il obtient son inscription en M1 de droit des assurances à l’université de Montpellier, dans sa fac. Pour le SCUM (Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier), cet événement met en lumière l’imposture que constitue le droit à la poursuite des études lors de la généralisation de la sélection à l’entrée en Master qui a été faite en 2017 [1].
Pour tout étudiant de licence, cette étape d’entrée en Master est devenue une source importante de stress et d’incertitude. Il est aujourd’hui possible de se voir refuser l’entrée à tous les Master, et d’être bloqué en L3. Tout cela parce que les logiques à l’œuvre entre Ministère, marché du travail, Universités, étudiants n’arrivent pas à trouver un point d’équilibre satisfaisant pour tous. Comment comprendre les logiques à l’œuvre et déconstruire les certitudes sur lesquelles elles reposent, de manière à mieux réfléchir sur des options d’avenir ?
Une licence aujourd’hui vaut le bac des années 70 [2]. Pourquoi ? Parce qu’un diplôme fonctionne comme une monnaie – plus il y a de monnaie en circulation, plus la valeur de la monnaie diminue. On se retrouve donc avec une logique de l’assignat. Pour lutter contre la déflation des diplômes, il faut donc, pour les esprits libéraux, assurer une certaine rareté du diplôme – ce qui est rare est cher. Cette intuition ne vaut que pour ceux qui y croient, mais malheureusement ils sont très nombreux. Pourquoi s’opposer à cette idée si partagée ? Parce que la culture, et donc la connaissance, n’est pas un bien comme les autres. Plus il est partagé, et donc courant, plus la capacité d’échanges d’informations, d’innovation, de création, de génie, de progrès augmente.
Si l’on prend l’exemple de l’art, la valeur sociale d’une œuvre dépend en grande partie du nombre de personnes qui la connaissent. La Joconde a plus de valeur au Louvre que dans la chambre de Léonard de Vinci. De même, les collections de Pinault et d’Arnaud ont plus de valeur dans des musées publics que dans leurs résidences privées – et c’est justement pour cela que ces collectionneurs organisent l’exposition des œuvres qu’ils détiennent. Cela fonctionne parce que le regard de chaque visiteur sur une œuvre d’art ne détruit pas l’œuvre d’art, ne lui enlève pas une part de matière, ou d’existence, et donc peut se partager de manière infinie sans problème.
La connaissance et la culture fonctionnent de la même manière – ce n’est pas un bien de consommation comme un autre. Une connaissance qui se partage n’est pas détruite par ce partage, contrairement à une voiture prêtée à un ami, ou un verre offert à un voisin. Il n’y a pas à proprement parler d’amortissement à opérer, de disparition de la matière par le prêt. Un cours universitaire peut se diffuser à l’infini sans détruire l’original du cours. C’est même le contraire – plus il circule, plus ses concepts sont soumis à des regards critiques différents, à des interprétations différentes, plus ce cours peut potentiellement prendre de la valeur. En résumé, la valeur de la connaissance ne fonctionne pas comme un produit habituel, au contraire c’est son échange et donc le nombre de personnes qui peuvent participer à cet échange qui en fait toute la valeur.
C’est bien le raisonnement qui a été tenu pour engager la France dans l’augmentation du niveau d’études. Avoir plus de bacheliers améliore la qualité de compréhension des employés, ouvriers ou techniciens, et plus généralement a un effet positif sur les organisations privées et publiques. Viser 80% de bacheliers dans une classe d’âge comme évoqué par Chevènement en 1985 était un objectif de rattrapage du Japon et de sa productivité, atteint en 2012. Ce que l’on oublie de dire, c’est que la productivité horaire en France a effectivement progressé fortement, et est aujourd’hui l’une des plus élevées du monde, largement au-dessus par exemple des Américains, des Anglais et même des Allemands. Et si l’on remonte plus loin dans le temps, les philosophes des Lumières avaient bien noté que démocratie et éducation étaient liées, et que l’organisation collective dépendait donc de la qualité des connaissances et de la culture des uns et des autres.
Pourquoi le diplôme universitaire niveau Master fonctionnerait-il donc, non pas comme un vecteur du progrès collectif qu’il faudrait au maximum encourager, mais comme un produit, dont la circulation fait baisser la valeur ?
L’étudiant de Montpellier s’est heurté à la politique de sélection mise en place par chaque université. Cette politique ne vient pas au hasard – elle résulte de la mise en place d’une forme de marchandisation de la connaissance dans un marché global d’offres et de demandes à la fois pour les étudiants et les professeurs. Pour attirer les meilleurs étudiants, il faut les meilleurs diplômes, et les meilleurs diplômes sont mesurés par les débouchés qu’ils offrent – taux de placement dans le marché du travail, niveau de rémunération, place dans les organisations publiques ou privées, etc…
Dans ce grand marché, le diplôme devient un passeport, une clé d’entrée, un outil de cooptation pour accéder à autre chose : un pouvoir d’achat, de consommation, une certaine idée de la sécurité matérielle et du bonheur. Évidemment, aucun de ces indicateurs d’évaluation des universités mondiales ne se fondent sur la qualité de l’esprit critique, la liberté de pensée, la créativité des anciens, leur contribution au progrès mondial de l’humanité. Ce qui compte, c’est le caractère marchand du diplôme devenu produit, devenu potentiel monétaire.
Ainsi, dans les 60 dernières années, la question de l’université est rentrée massivement dans le champ de l’économie libérale, comme un produit comme un autre. Du coup, la spécificité de la connaissance comme bien partageable infini s’est perdue. S’il n’y a pas de valeur de la connaissance du point de vue collectif ou à long terme, alors ce qui fait la valeur d’une formation est effectivement sa cotation boursière sur le marché de l’emploi. Et les universités, dans ce monde marchandéifié, ont pleinement joué l’adaptation, sans réserve, en courant les unes contre les autres.
L’étudiant a donc fait grève pour avoir un passeport pour son premier emploi, et l’université ne l’a pas retenu parce qu’il était lui-même un des éléments de la concurrence entre les universités, un peu comme l’on sélectionne les bonnes ou mauvaises graines de cafés. La marchandisation de l’éducation universitaire entraîne à la fois la sélectivité concurrentielle des universités et le rejet des désirs individuels pour apprendre. Ce n’est pas le plaisir ou le désir d’apprendre qui différencie les bons étudiants des mauvais dans leur entrée en Master, mais leurs notes, leurs dossiers, leur profil objectif. Tout le processus s’est effondré du point de vue qualitatif pour se réduire à des éléments les plus tangibles possibles, les plus apparemment neutres, mais aussi les plus partiels.
Au total, ce fait divers illustre un dilemme social majeur. D’un côté, la question de la sélectivité liée elle-même à une organisation sociale méritocratique et concurrentielle. De l’autre, la revendication individuelle mais aussi collective à un droit à l’éducation vue non pas sous l’angle de la performance professionnelle, mais sous l’angle de la liberté de progresser et d’apprendre.
Le droit est en faveur de la liberté de l’individu, mais il y a un problème d’application de la loi face à des comportements sociologiques. Cet étudiant devait, au titre de la loi sur la poursuite des études mis en place par Najat Vallaud-Belkacem en 2017, avoir au minimum trois propositions obligatoires de Master concernant son cursus de licence dans la même académie. Mais l’académie a du mal à imposer cette position de droit à des universités prises dans la logique de la compétition, que l’académie elle-même accepte et soutient. En tirant ce fil, on voit bien l’injonction contradictoire à l’œuvre, et qui se traduit par une position ambivalente au mieux, et hypocrite au pire, de l’académie et des universités. Le droit c’est bien, mais pas trop vite, pas trop fort, pas au prix de la relégation. Il y a là, clairement, une question de priorisation et d’équilibre des objectifs donnés au niveau d’institutions publiques, et comment sont définis les équilibres de pouvoirs et contre-pouvoirs dans la mise en œuvre des textes de lois. De manière encore plus importante, il faut bien voir dans ce fait divers un exemple parmi des dizaines d’une question qui divise les spécialistes de l’éducation (pédagogues ou non).
D’un côté, des intellectuels, souvent diplômés de grandes écoles comme l’ENS-Ulm (comme Brighelli ou Finkelkraut), défendent le modèle de l’école de la IIIème République avec une sélectivité forte. Le collège unique est une horreur pour eux. Dans cette logique, l’Éducation Nationale devrait être en mesure de savoir le plus tôt possible qui a le droit de continuer ses études ou non pour permettre un niveau moyen plus élevé et une revalorisation des examens et des concours comme le bac ou la licence. C’est un modèle sélectif voire darwinien assumé : les quelques individus ainsi repérés et formés deviennent à leur tour les meilleurs étendards du système méritocratique et de la République. Il est vrai que dans ce modèle beaucoup sont laissés sur le banc de touche – ce n’est pas le plus grave dans notre approche, et pourtant cela pose question. Ce qui est plus grave selon nous, c’est surtout que cette pensée imagine le modèle éducatif sans lien avec la sociologie et les comportements culturels. Notre environnement sociologique n’est plus celui des années 60 ou avant. Dans notre environnement actuel, il nous faut prendre comme donnée d’entrée que le diplôme est une commodité. Du coup, il devient beaucoup plus dur de pouvoir s’insérer dans le marché du travail sans aucun diplôme (94% des personnes incarcérées ont un niveau infra bac{3] ). Mettre en œuvre un programme de sélectivité des années 60 dans une société du XXIème siècle, mondialisée, d’éducation massive et personnalisée, et très souvent privée serait une hérésie, comme celle de relancer le Minitel dans un monde Internet.
De l’autre côté, il y a le point de vue de ceux qui veulent mettre l’individu (“l’apprenant”) au centre du système éducatif. Dans cette approche, il faut développer la capacité du système à répondre au droit à l’éducation, avec une contrainte de respect d’égalité des chances. Il faut dès lors trouver des modalités d’examens, de concours, et plus généralement un processus d’orientation et d’éducation qui permette un recul de la sélectivité sous ses modalités actuelles. La sélectivité des étudiants imposés à 13 ans ou 20 ans est contradictoire avec l’augmentation de l’espérance de vie et la multiplication des canaux possibles de formation, et le besoin de formation continue et de spécialisation pointue des individus. En maintenant une aristocratie du système au niveau du bac ou autour, le système français reste dans le modèle du moyen-âge des chevaliers bacheliers qui devait être identifié tôt pour une vie de moins de 40 ans. Ce principe de sélectivité rapide est aussi profondément brutal et inégalitaire. Notre école en France accroît les inégalités sociales – nous sommes le pays européen avec le plus fort taux de déterminisme sociale PISA. Il va aussi dans le sens d’une baisse globale de niveaux (20% des élèves arrivant au collège ne maîtrise pas la compétence 1 : lire et écrire [4] ). Pour finir, en comparaison historique, ce système entraîne une dévalorisation du diplôme – une licence d’aujourd’hui vaut un bac des années 70 sur le marché du travail. Pour revaloriser les études et sortir de la commoditisation et de la baisse de qualité, il ne faut donc pas renoncer à la sélectivité, il faut pouvoir la gérer mieux au niveau de la vie, et s’assurer qu’une personne peut re-rentrer dans le système à tout moment, et au niveau qui lui va pour aller vers le plus haut possible. Inventer en quelque sorte une sélectivité du marathon et non une sélectivité de la course de vitesse.
Amaël OURVOIE, Directeur du Pôle Éducation
[1] Ouest-France, 23 septembre 2020
[2] Durut-Bellat M., L’inflation scolaire – Les désillusions de la méritocratie, La République des Idées – Seuil, Paris, 2006
[3]Faron O. et Duchêne T., Former, Ed. de l’Aube, Paris, 2019
[4 Brighelli S., A bonne ècole , Essais-Ed. JC.Gawsewitch,Paris, 2005]