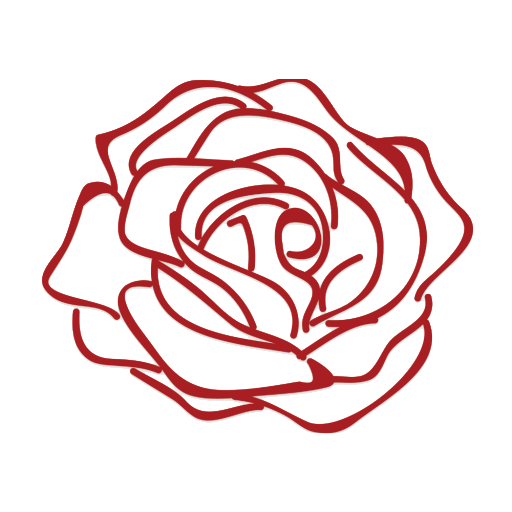 Groupe Socialiste Universitaire
Groupe Socialiste UniversitairePosté le 29 janvier 2020 par Groupe Socialiste Universitaire

PREMIER PARTIE
Par Sacha Pasquier, directeur des recherches du GSU, Rémi Cattarin, trésorier du GSU de Bordeaux, Sami Hmissi, chef du pôle économique et social
Mercredi 26 mars 1986, François Mitterrand refuse de signer les ordonnances qui ouvrent le capital de la BNP, du Crédit Lyonnais et de la Société Générale au secteur privé. La cohabitation avec le gouvernement Chirac est plus que tumultueuse, à l’image du débat idéologique qui s’enracine autour de la question des privatisations. Les tenants d’une droite bonapartiste (sous l’égide d’un jeune Jacques Chirac connu pour être le « bulldozer ») motivent toute forme de privatisation du capital au nom de la nécessité de réduire la dette publique et d’ouvrir ce qui fut « les champions d’une économie dirigée » à la libre concurrence, remède miracle aux ravages des chocs pétroliers de 1973 et 1975. De l’autre côté, les socialistes menés par Lionel Jospin se portent en garde-fou de l’intérêt général qui, à ce rythme lui aussi, pourrait se voir indexé au CAC 40. Consciente du pathos politique d’une telle notion, la droite n’a eu de cesse depuis de vouloir s’en approprier le patronage. Aux yeux des libéraux les plus désinhibés, privatiser signifie pérenniser.
Pour autant, est-il réellement possible de justifier les privatisations au nom de l’intérêt général ? Difficile à dire lorsque l’on s’intéresse à ce que cela implique en termes de gouvernance d’entreprise. Il suffit d’ajouter à cela l’exemple des autoroutes pour assombrir les effets soi-disant bénéfiques de la magnanime main invisible d’Adam Smith.
Aborder le sujet de la privatisation, c’est batailler avec les notions de souveraineté économique, d’ingérence politique et de libre-concurrence mais c’est surtout penser et repenser le concept clé de la puissance administrative qu’est la France : l’intérêt général. Si notre pays a fait le choix d’assoir l’autonomie (au sens littéral du terme) de son administration dans un ensemble indépendant du bras civil de notre corps judiciaire, c’est justement pour défendre l’intérêt supérieur de la Nation dans son ensemble face à la multitude d’intérêts privés.
Avant toute chose, rappelons qu’une privatisation est un transfert de propriété entre le secteur public et le secteur privé. Pour se faire, plusieurs solutions existent :
Devenir actionnaire permet d’acquérir un certain nombre de droits, comme voter les décisions stratégiques au sein des assemblés générales par exemple, mais aussi de percevoir une part relative des bénéfices. De ce fait, privatiser implique un appauvrissement des apports de fonds pour l’Etat mais aussi l’inférence des considérations personnelles de l’investisseur dans le devenir d’une entreprise.
Pour comprendre la vague de privatisations qui s’abat sur la France depuis les années 1980, il faut inévitablement revenir sur les nationalisations mitterrandiennes. Avec la signature du Programme Commun en 1972 par le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Radicaux de Gauche, le débat sur les nationalisations est amorcé. Il se concrétisera dans les « 110 propositions » à visée programmatique du candidat Mitterrand à l’élection présidentielle de 1981. Ce sont alors cinq groupes industriels français (Thomson, Rhône Poulenc, Péchiney, Saint-Gobain, Usinor), trente-six banques privées de dépôt et deux compagnies financières, Paribas et Suez, qui sont sous le joug d’une nationalisation. Le Parti Socialiste porte à bouts de bras l’un des bouleversements économiques majeurs de la France libérée. L’opposition crie à l’hérésie économique, alors que la gauche s’évertue à reprendre en main les leviers d’une économie dont l’ingérence étrangère se camoufle sous la cape de la mondialisation. Conscient des affres du « mur d’argent » (en référence à l’influence grandissante des sociétés financières sur la société civile), le PS organise la riposte française pour assurer la primauté de l’utilité publique sur les vicissitudes d’un quelconque cours de bourse.
Malheureusement, nationaliser n’était nullement une fin en soi. Le véritable enjeu se trouvait dans les possibilités offertes en matière de gouvernance pour l’État français. Les gouvernements successifs se sont fourvoyés et ont confondu administration publique et rentabilité économique. Plaçant les « amis du parti » à la tête de ses sociétés, il était, un temps, de bon aloi d’administrer les sociétés nationalisées comme s’il s’agissait d’administrations publiques. Au-delà des déboires économiques, le véritable échec de cette politique est l’ensemble des espoirs déçus. Bien que les sociétés Péchiney et Rhône-Poulenc aient tiré leur épingle du jeu, les espérances nées des années 1982-1984 ont vite tourné au vinaigre. En effet, en privatisant les sociétés de dépôt et de crédit, le gouvernement socialiste prenait le contrôle de l’ensemble du mécanisme de pourvois de fonds à l’économie. Jouant de son influence au sein des différents conseils d’administration, il assoit sa conception d’une entreprise socialement responsable en améliorant notamment les conditions de formation. Seulement dès 1984, une politique de la rigueur plus qu’hasardeuse permet aux sociétés financières de réinstaller une gestion plus « classique ». Petit à petit les « contrats de plan » sont vidés de leur substance jusqu’à ce qu’une réforme bancaire d’inspiration anglo-saxonne assène le coup de grâce à une politique de nationalisation aux résultats très mitigés.
Il est monnaie courante d’entendre esclandres et algarades en tout genre contre le vent libéral qu’insuffle l’Union Européenne au sein des économies des différents pays membres. Pour beaucoup, en se positionnant ainsi , la gauche marche à contre-courant de son temps. La puissance qu’offrirait le régionalisme européen justifierait toutes les lubies bruxelloises. Oui, le prix Nobel de paix millésime 2012 gagnerait à avancer vers le projet d’« États-Unis d’Europe » pensé par Jean Monnet. Seulement, la construction d’un État-nation européen ne peut se réduire à la fomentation d’un grand marché capitaliste et dérégulé.
Pour autant, la technocratie européenne ne semble pas percevoir la nécessité de préserver le droit de regard du gouvernement dans les affaires d’entreprises dont l’impact sociétal influe directement sur le quotidien des concitoyens. Preuve en est la procédure d’infraction lancée en 2018 contre 8 pays et notamment la France pour « imposer le respect du droit de l’UE » quant aux marchés publics de l’hydroélectricité. Veuillez comprendre qu’il est demandé à la France de se mettre en conformité avec le fameux article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, royaume de la libre concurrence. A cette date, la France possède le second parc hydroélectrique d’Europe et ce depuis l’après-guerre. Afin de préserver l’influence régalienne qui lui échoie de droit et de fait, elle organise la concession de 399 installations aux deux opérateurs historiques de l’énergie française. Piliers de la transition énergétique, ces concessions produisent à elles-seules 15% de l’électricité de notre pays. Afin de garantir la continuité dans la gestion de système productif de notre électricité, les concessionnaires historiques ont « un privilège » lors des appels d’offre au nom de l’intérêt général d’une gestion pérenne. Pernicieusement, Bruxelles ne condamne pas la place qu’occupe la France dans l’actionnariat de ces sociétés mais réfute ce droit de privilège. Ainsi, les sociétés d’intérêt public se trouvent en concurrence avec les intérêts de groupes privés du secteur énergétique. Ici, c’est un engagement fort qui est pris à l’encontre de la nationalisation puisque l’Union Européenne ne se contente pas de contester les politiques de nationalisation, elle se place également aux côtés de ses contempteurs.
Focus sur l’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne :
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.
3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.
Avec le plan « Proust », l’idée d’un réseau autoroutier naît dès 1934 mais est avortée par une guerre retranchant l’humanité aux confins de l’atrocité. Une fois la Libération sonnée par le bourdon de Notre-Dame, le réseau autoroutier est aussitôt considéré. Ainsi, lors de l’année 1946, c’est avec l’« autoroute de l’Ouest » que les 26 premiers kilomètres d’autoroutes françaises sont concrétisés. A ce jour, le parc autoroutier représente 11 882 kilomètres de péages et de bitume. Il se hisse au 3ème rang européen et au 8ème rang mondial.
Dès 1955, le gouvernement d’Edgar Faure accorde à des sociétés privées la gestion d’une partie de ce même réseau par le biais de contrats de concession. Sont alors créées des sociétés d’économies mixtes concessionnaires d’autoroutes (SEMCA) ayant droit de regard sur le développement des infrastructures et la liberté de fixer les conditions d’une offre tarifée se devant d’être ratifiée par l’exécutif pour se parer d’une certaine légitimité. Lentement mais sûrement, les groupes d’intérêts automobiles et autoroutiers renégociaient les contrats de concessions appuyés par d’importantes activités de lobbying au sein de l’hémicycle. Au fil des années, ces SEMCA qui étaient des sociétés que l’on aurait pu qualifier de partenariat public-privé sont tombées totalement dans le secteur privé, entrainant avec elles la gestion et le développement des autoroutes françaises. Dans les nombreux cas où l’État a souhaité imposer aux SEMCA la construction de nouvelles routes, n’étant pas prévu dans les accords initiaux, une clause dans les contrats a permis à chaque SEMCA de renégocier les conditions de la concession à travers un amendement nommé un « Contrat de plan ». Grâce à ces contrats, une extension de la concession ainsi qu’une potentielle hausse de frais supplémentaires a pu permettre aux SEMCA de financer ces nouveaux engagements.
Pour aborder le sujet de la « privatisation des autoroutes », il serait plus juste de parler de la privatisation des SEMCA « historiques », car les autoroutes en tant que telles restent toujours dans le domaine public. Alors que leurs ventes très médiatisées ont eu lieu en 2006, les premières instances de considération envers une telle politique ont commencé vers la fin des années 2000. En mars 2001, le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, Laurent Fabius, a ré-établi les conditions et statut des contrats des concession détenus par les SEMCA historiques afin qu’ils soient en accord avec ceux accordés aux sociétés privées. Notamment, ces sociétés ont pu voir leurs concessions étendues jusqu’à la période 2026-2032 afin de leur permettre de concourir à l’international. La même année, le Premier ministre, Lionel Jospin, a autorisé la privatisation partielle de la SEMCA Autoroute du sud de la France (ASF) avec une mise en bourse de 49 % du capital, récoltant ainsi 1,8 Milliards d‘euros. Suite à cette première vague de privatisation, la question de la vente totale des SEMCA s’est incrustée dans le débat public.
C’est alors en 2006 sous le gouvernement de Villepin que la totalité des parts tenues par l’État dans les SEMCA ont été vendues. Suite à un accord avec les groupes, Vinci, Eiffage et Abertis, 14,8 milliards d’euros ont été cédés à l’État, marquant ainsi la fin des SEMCA publiques en France. Autrement que par les simples bénéfices monétaires, cette privatisation fut motivée, selon la majorité de l’époque, par une clarification du rôle de l’état. Plus précisément, il aurait auparavant existé une confusion entre l’État en tant que régulateur de l’économie et l’État en tant que détenteur de patrimoine[1]. Bien que l’État puisse exercer ces deux rôles, les décideurs publics ont jugé que le cas des SEMCA ne présentait pas les caractéristiques qui exigeaient que l’État en soit propriétaire, actant ainsi son rôle de régulateur. 13 ans plus tard, la privatisation des autoroutes reste toujours sujette à de nombreuses controverses. Dans la perspective de la privatisation de la Française des jeux ainsi que les Aéroports de Paris, il serait alors pertinent de comprendre pourquoi la vente des SEMCA peut être considérée comme un échec.
Suite à la privatisation de 2006, un des constats les plus médiatisés a été la hausse des tarifs routiers, et notamment le fait que ces augmentations furent systématiquement supérieures à l’inflation. Étant donné que les grands groupes propriétaires ne détiennent pas une liberté absolue sur la mise en place de leurs tarifs, il est alors étonnant que l’État n’ait pas pu empêcher cet envol.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Hausses moyennes des tarifs pour des SEMCA « historiques » | 3,06% | 2,02% | 3,36% | 2,98% | 1,00% | 2,78% | 2,79% |
| Indice des prix de la consommation hors tabac[2] | 1,91% | 1,07% | 1,92% | 2,70% | -0,22% | 1,52% | 2,25% |
Alors que l’Etat est en obligation, suite au décret de 1995, d’accepter une hausse minimale de 70 % de l’inflation chaque année, il est néanmoins en capacité d’accorder une hausse plus forte en échange d’un investissement supplémentaire sur les réseaux d’autoroutes. Selon un rapport de la Cour des comptes, l’augmentation considérable des revenus détenus par les nouveaux propriétaires des SEMCA peut être majoritairement attribuée aux hausses de ces tarifs qui représentent en soi 97% des recettes chaque année. Cet “effet-prix” est davantage critiquable, compte tenu du fait que l’effet trafic est principalement négligeable sur les recettes depuis la privatisation de 2006. Pour exemple, alors que la France a observé une baisse nette de trafic en 2012, les SEMCA ASF, ESCOTA, APRE et AREA ont toutes vu une hausse de leurs recettes pour la même année. Bien que ces augmentations aient été accordées dans le cadre d’un contrat de plan, les accords et les hausses observés peuvent être contestés en deux temps :
Les projets d’investissement qui ont justifié les hausses supplémentaires ne sont plus les mêmes que ceux précédant la vente de 2006
Si auparavant les investissements complémentaires intégrés dans les contrats de plan représentaient des sommes importantes pour financer des projets d’infrastructures considérables, les projets modernes sont maintenant d’une plus faible ampleur. Le potentiel élargissement du réseau autoroutier étant beaucoup plus restreint à présent, les nouveaux projets validés ont donc été plus petits en taille et inscrits dans une volonté d’amélioration des infrastructures préexistantes (télépéages, traitement de bruits, aménagement de territoire déjà exploité …). Leur caractère contestable est alors dû au fait que l’investissement ne représente pas de vraies démarches pour rendre les structures plus utiles aux automobilistes, mais plutôt des investissements bénéfiques pour les concessionnaires principalement. Dans le cas de l’installation du système de télépéages notamment, fortement compensée lors des contrats de plan établis entre 2009-2013, cette nouvelle possibilité de tarification par abonnement aurait probablement été implémentée en l’absence d’un contrat. En contextualisant ceci dans le cadre de la privatisation des SEMCA, il est donc possible d’argumenter que la perte de contrôle de ces sociétés a permis aux grands groupes propriétaires de financer leur démarche d’optimisation, et même de maintenance, à la charge des automobilistes et non grâce à la mobilisation des fonds propres.
La perte de contrôle a vu naître des pratiques non compétitives et contestables
Autre que dans le cas des contrats de travail, les SEMCA privatisées ont notamment pu augmenter leurs tarifs par des pratiques contestables, et potentiellement anti-compétitives. Dans ce sens-là, il existe des méthodes permettant la maximisation des revenus tout en restant (de manière superficielle) dans les conditions établies dans les contrats de concession. Cette pratique du foissonage, condamnée en 2008, consiste à répartir les hausses de tarifs autorisées afin que les trajets les plus fréquentés deviennent porteurs principaux de l’augmentation des frais. Alors que la hausse accordée par l’Etat est une moyenne sur la totalité du réseau, le foissonage permet de dépasser cette limite sur les voies clefs et ainsi d’optimiser les recettes pour l’année. Cette pratique ayant déjà été sanctionnée, la Cour des comptes a néanmoins déclaré que les indus de foisonnement n’ont pas encore été complètement récupérés, et que les conditions de ces transferts restent tout de même trop favorables envers les SEMCA. Si cette pratique a pu disparaître avant l’année 2012, des manœuvres anti-compétitives mises en place par les grands groupes propriétaires restent à présent toujours contestables (avec notamment le learning mangement, né avec les nouvelles dispositions sur les IFRS9).
Comme a pu le noter l’Autorité de la concurrence, une autoroute représente un potentiel monopole limité dans le temps et l’espace. Le faible effet de substitution que détiennent les alternatives aux autoroutes ne permet donc pas la liberté de choix absolue pour les automobilistes, qui justifient alors le devoir qu’a l’État d’exercer un contrôle sur les tarifs. Cependant, dans le cas des autoroutes, le “marché” des trajets n’est pas le seul secteur concerné, puisque les groupes VINCI et EIFFAGE sont principalement actifs dans le domaine de la construction. Selon l’Autorité de la concurrence, la grande majorité des contrats de construction accordés dans les cadres des projets issus des contrats de plan ont, depuis 2006, été attribués à des organismes liés directement à ces groupes sans avoir eu recours à un appel d’offre. Cela veut donc dire que dans l’absence d’adéquation de l’offre et de la demande, les prix d’investissement retenus dans les contrats de plan sont largement contestables. En conjoncture avec les hypothèses macro-économiques utilisées dans l’élaboration des contrats (que la Cour de comptes déclare être fortement favorables envers les SEMCA), la tarification des autoroutes a alors été d’avantage excessive depuis la privatisation de 2006. Plus largement, l’utilisation de constructeurs partenaires représente potentiellement une démarche monopoliste qui établit un circuit court pour les groupes propriétaires, empêchant donc les investissements négociés de réellement stimuler et accroître l’économie locale.
Dans le cas des autoroutes, la vente des SEMCA en 2006 a suscité énormément de controverses, dont les contestations persistent toujours aujourd’hui. Lors des manifestations du mouvement « Gillet Jaune », plusieurs arrêts de péages ont été bloqués, dans certains cas détruits, les frais trop élevés étant alors utilisés comme justification. Étant donnée la manière dont les SEMCA ont été privatisées et les mécanismes qui ont créé la trop forte augmentation des prix, il existe alors deux solutions potentielles. Dans un premier temps, le rachat complet des SEMCA et la réattribution du contrôle tarifaire envers l’Etat pourrait largement réduire effets contestables. Cela dit, ce rachat se porterait extrêmement coûteux avec des estimations entre 20 et 50 Milliards d’euros[3]. Supposons qu’un tel achat soit effectivement validé par l’état, (il est important de rappeler qu’une proposition de nationalisation des SEMCA a été rejetée par le Sénat en 2019), le modelé concessionnaire sur lequel fonctionnent les SEMCA empêcherait potentiellement cet investissement d’être rentable sur le long terme. Pour rappel, ce modèle privilégie la construction rapide, financée par un investissement externe qui sera rentabilisé sur le long terme grâce aux tarifs de péages. Alors que 2006, selon certains experts[OT3] , a été le point tournant pour les autoroutes, passant de déficitaires à rentables, un rachat complet des SEMCA aujourd’hui imposerait non seulement le remboursement des infrastructures en tant que telles, mais aussi la perte considérable de revenus potentiels. Il n’est alors pas certain que cette opération pourrait être financée avec des frais inférieurs à ceux observés à présent étant donné le faible potentiel d’élargissement du réseau. La deuxième solution porte sur une plus forte réglementation des contrats de plan. Comme l’a proposé la Cour des comptes, les termes et conditions de ces contrats doivent être précisés en amont afin de distinguer les investissements compensables par une hausse de frais légitime et les investissements qui ne méritent pas ce statut. Deuxièmement, il serait envisageable de réformer, pour les SEMCA, la loi portant sur la nécessité d’un appel d’offre pour tout projet au-dessus de 500,000 euros. Proposée par l’Autorité de la concurrence, cette réforme permettrait d’identifier les vrais coûts des projets de construction proposés dans le cadre des contrats de plan, ainsi qu’alléger les effets néfastes liés à la nature monopoliste que détiennent les SEMCA à l’échelle locale.
La vente des autoroutes en 2006 a pu générer pour les acheteurs des revenus considérables dont l’État n’a pas pu bénéficier. Alors qu’en théorie, ceci a été compensé par le prix de l’achat, jugé trop faible par la Cour des comptes, nous pouvons observer aujourd’hui que la perte de contrôle des SEMCA a pu créer des mécanismes contestables qui nuisent toujours au pouvoir d’achat des Français. Comme l’a pu être démontré, les SEMCA détiennent une liberté favorable et contestable quant à leurs tarifications, qu’ils ont pu exploiter grâce aux limites que comportent les contrats de concession privatisée. Les perspectives d’évolution étant extrêmement contraintes par les coûts qu’elles peuvent susciter, cette problématique ne peut que servir de leçon quand nous considérons le projet de privatisation des Aéroports de Paris, fonctionnant aussi sur un modèle concessionnaire.
L’un des prieurés de l’argumentaire en faveur des nationalisations est la défense de la souveraineté. L’État disposant du pouvoir de contrôle dans des secteurs aussi stratégiques que les transports ou l’énergie assure son indépendance par rapport aux autres puissances. Au-delà des questions purement économiques, ce sont parfois des enjeux géopolitiques qui peuvent intervenir lorsqu’il s’agit de privatiser des entreprises stratégiques à une société étrangère hors de l’UE ou appartenant à son État d’origine. Ces enjeux pouvant aussi s’analyser sous le prisme d’entreprises non-publiques mais néanmoins stratégiques (telle qu’Alstom Énergie, vendu à l’américain General Electric, ou encore Latécoère), une autre réflexion s’imposera ultérieurement sur ce débat.
Actuellement, cette situation peut s’illustrer par la vente de la société de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac, rachetée par une entreprise chinoise, ou de celle d’Aéroport de Paris, qui doit être vendu au groupe Vinci. Le domaine aéroportuaire comporte une part d’intérêt régalien puisqu’un aéroport est une frontière nationale, mais aussi européenne. La nature même d’un État étant assujettie à la défense et au contrôle de ses frontières, leur gestion administrative et sécuritaire ne devrait pas être déléguée à une entreprise privée.
La souveraineté peut aussi être prise sous le regard démocratique. Les entreprises publiques ont été financées par les deniers publics pour répondre à un besoin ayant trait à l’intérêt général : la SNCF en assurant le transport des personnes dans tout le pays, EDF en fournissant l’énergie pour faire fonctionner toute la France et une partie de l’Europe, ou encore Aéroport de Paris pour relier la France au monde… Le temps n’en a pas fait disparaître l’intérêt général, fondation de toutes ces entreprises. Nous avons toujours besoin de transports pour desservir tous les territoires, d’aéroports pour rester connectés avec le monde, ou encore d’énergie pour alimenter toutes nos activités, qui ne s’inscrivent pas dans une logique de rentabilité. En effet, il est évident qu’une ligne de train ou de bus qui dessert une petite commune sera moins rentable qu’une ligne desservant une grande métropole. L’idée de l’intérêt général est précisément de répondre aux besoins de cette petite commune, qui doit rester en contact permanent avec le reste du territoire, qui peut financer solidairement sa connexion ferrée ou routière.
Tous ces besoins n’ont pu être assurés par des acteurs privés car l’investissement nécessaire pour former tous ces secteurs est trop important. De plus, soit la rentabilité n’est pas assurée, soit le temps est trop long. Nous le voyons avec les entreprises publiques, leur déficit est structurel et leur survie conditionnée par les subventions de l’État.
La question démocratique arrive précisément là. Tous les français contribuent d’une manière ou d’une autre au financement de la collectivité publique, qui doit assurer ses missions. En privatisant des entreprises ou en accordant de plus en plus de place à une logique comptable, nous réduisons l’accès à ces services pour de nombreux citoyens, alors même qu’ils ont contribué à leur financement. Les citoyens contribuent à la collectivité pour qu’elle réponde à leurs besoins et non à ceux de l’intérêt privé. C’est ainsi une perte de pouvoir pour nous tous, puisque nous aurons perdu une part importante de contrôle dans la direction de cette entreprise après sa sortie du domaine public.
De fait, cette analyse nous a amené à demander à l’économiste Christophe Ramaux et au sénateur et président groupe Socialiste et Républicain au Sénat Patrick Kanner s’il n’était pas nécessaire de se diriger vers un protectionnisme stratégique sur des outils de notre souveraineté. Leurs réponses nous a permis de consolider notre opinion et nos travaux.
Nous vous invitons à retrouver leurs réponses et certaines conclusions de nos travaux sur ce sujet dans la deuxième partie de cette étude qui sera publiée dans les prochains jours.
Bibliographie pour aller plus loin :
[1] « La privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes est une bonne décision. Elle aide – oblige – à clarifier le rôle de l’État, le prémunissant de la confusion des rôles entre régulateur et détenteur de patrimoine. » – Hervé MARITON, Député – Commission des finances, de l’économie générale et du plan- 2005.
[2] Source : DIT
[3] Senat – Nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes – 2019